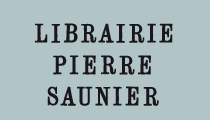Édition originale.
Exemplaire du Naboukoudouroussour, Ernest Feydeau, portant ce précieux envoi a. s. :
à mon vieux Feydeau, Gustave Flaubert
Vous êtes faits pour vous comprendre et vous aimer – c’est ainsi que Théophile Gautier aurait présenté Flaubert à Feydeau au début de l’année 1857 et c’est ce qui advint.
L’année précédente, les deux écrivains, nés la même année (1821), viennent de débuter leur carrière littéraire : Flaubert a prépublié Madame Bovary dans la Revue de Paris, Feydeau son Histoire des usages funèbres et des sépultures des peuples anciens, une très sérieuse étude qu’exploite alors Gautier pour son Roman de la Momie (1858) et que Flaubert va aussi largement utiliser dans la préparation de Salammbô – il presse même son auteur à publier le deuxième tome de son ouvrage, car j’en ai besoin … Flaubert est également séduit par les idées nouvelles de Feydeau sur sa façon de pratiquer l’histoire avec les intuitions et l’imagination d’un romancier, idées qu’il a fait siennes quand il expose à Maxime du Camp sa théorie du roman comme document historique par excellence.
Bref, Feydeau devient dès leur rencontre le correspondant privilégié de Flaubert.
Ensemble ils poursuivent une très abondante correspondance littéraire et intime qui témoigne de ce lien privilégié comme de la compréhension immédiate qu’ils ont l’un de l’autre, valorisant de conserve un art intransigeant voué au travail et à la solitude partageant un goût prononcé pour la provocation, une liberté de ton dans les échanges, une ironie à laquelle se mêle une large part d’autodérision ; protestations d’amitié, demandes de nouvelles, impatience à se retrouver, reproches face à un silence jugé trop long rythment leur dialogue épistolaire qui donne à voir une proximité que Feydeau érigera, dans ses souvenirs, en véritable mythe d’une complémentarité parfaite.
Indispensables l’un à l’autre, ils fréquentent les mêmes salons littéraires, celui de la Présidente notamment (Madame Sabatier), les mêmes dîners mondains comme les fameux dîners Magny auxquels assistent les Goncourt, Sand, Renan, Taine, Tourgueniev, etc. Flaubert invite régulièrement Feydeau à Croisset et ne manque jamais de le retrouver lors de ses propres séjours parisiens.
Lorsque Feydeau, délaissant l’archéologie et l’histoire, se lance dans la publication de romans, Flaubert ne ménage pas son vieux Naboukoudouroussour de ses précieux conseils et corrige copieusement ses manuscrits. Fanny, son premier roman inspiré de Madame Bovary – étude d’un adultère parisien qui défraie tout autant la chronique – lui vaut l’admiration de ses pairs, tout particulièrement celle de Sainte-Beuve qui glorifie l’œuvre qu’il considère comme une des bibles de ce temps … On se souvient de l’envoi qu’inscrit alors Feydeau sur l’exemplaire qu’il offre à son ami : A Gustave Flaubert que j’admire comme un maître et que j’aime de tout mon cœur, comme un frère. E. Feydeau.
Las, ébloui par cette miroitante réussite, Feydeau s’abandonne à la facilité, publiant pas moins de cinq romans durant les cinq années que Flaubert met, avec l’exigence de la perfection, à écrire Salammbô… L’art intransigeant en souffrit un peu mais l’amitié demeura, inébranlable, d’année en année plus filiale – et Flaubert de signer certaines lettres à son aimable neveu, Ton Oncle. S’il ne reconnut jamais publiquement Feydeau qui le sollicita maintes fois pour un article ou une critique, Flaubert, frère loyal, lui règlera sa dette en devenant son mentor protecteur. Élève ou disciple (titres qu’il adopte de lui-même), Feydeau s’effacera progressivement dans le prestigieux sillage du Maître.
Sans jamais avoir pu renouveler le succès de Fanny et peut-être un peu jaloux de celui de Salammbô qui consacrait Flaubert dans son statut de grand écrivain, Feydeau lui écrivit en décembre 1863 : Tu as eu de la chance pour ton second bouquin. Rappelle-toi comment on s’est conduit avec moi … le jour de l’apparition de Daniel. Tu as donc eu de la chance, pour ton second bouquin, mais gare au troisième ! Sur ce point, il ne s’était pas trompé : L’Éducation sentimentale fut mal accueillie par la critique et le public.
Quelques mois après avoir reçu L’Éducation sentimentale, Feydeau eut une attaque qui le laissa paralysé et sans ressource. Flaubert lui obtint une pension auprès du Ministère de l’instruction publique pour l’empêcher de mourir de faim. Il fut encore à la manœuvre l’année suivante pour un dernier secours. Feydeau mourut d’une rupture d’anévrisme le 29 octobre 1873. Flaubert eut cette triste pensée : Tant mieux pour lui, du reste.
Touchant exemplaire d’Ernest Feydeau, témoignage d’une indéfectible amitié – Flaubert a certainement fait relier cet exemplaire pour l’offrir à son vieil ami, inscrivant sa dédicace sur un des feuillets de garde de la reliure. Quelques marques de lectures au crayon à papier.
Ex-libris Musaeo Hans Fürtstenberg & Bibliothèque Jean Meyer (n°127, vente du 4 Juin 1996)